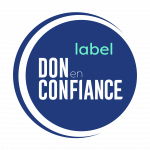A l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, les travailleuses du sexe mobilisées pour un meilleur accès à la santé et la défense de leurs droits prennent la parole. Au Burundi, pays enclavé de l’Afrique de l’Est où agit l’association ANSS, membre de Coalition PLUS, les travailleuses du sexe, cis ou transgenres, sont particulièrement vulnérables au VIH. En 2019, sur près de 600 femmes exerçant ce métier dépistées par l’ANSS, plus de 100 étaient séropositives.
La précarité, facteur d’entrée des femmes dans le travail du sexe
La pauvreté, déjà prégnante auparavant au Burundi, s’est accentuée ces dernières années avec la crise socio-politique qui a frappé le pays en 2015. Aujourd’hui, on estime que près des trois quarts de la population vit sous le seuil de pauvreté défini par la Banque mondiale (1,90 dollar US par jour) (Banque mondiale, 2018). Les femmes, qui participent pourtant à l’économie nationale au même titre que les hommes, sont particulièrement touchées par cette situation. En effet, si les mentalités évoluent, les discriminations et violences basées sur le genre persistent.
Dans ce contexte, certaines femmes choisissent le travail du sexe comme moyen de survie. C’était le cas de Cynthia, 24 ans, maman d’un bébé de trois mois. Elle raconte : “Il y a 6 ans, je suis venue à la capitale chercher du travail. Je gardais d’abord des enfants. Mais après quelques mois, je suis tombée enceinte et j’ai du arrêter de travailler. C’est à partir de là, pour subvenir à mes besoins, que j’ai commencé le métier de travailleuse de sexe dans les bars. J’étais enceinte et c’était difficile… J’ai perdu mon bébé quelques semaines après sa naissance”.
Lorsqu’elle travaillait, Cynthia recevait trois clients en moyenne par jour, pour l’équivalent de 2,50€ à 5€ la passe. Cela lui permettait tout juste de payer son loyer et d’acheter de quoi manger.
Les femmes transgenres, victimes de discriminations quotidiennes
Maya, 25 ans, a commencé à pratiquer le travail du sexe en 2005. Pour elle aussi, la pauvreté a été un facteur d’entrée dans le métier. Comme elle le dit elle-même, “ce n’est pas un travail qu’[elle] aimerait continuer à faire si [elle] pouvait gagner [sa] vie autrement”. Mais c’est surtout la transphobie qui l’a poussée à se prostituer. “C’est l’ignorance de mes parents qui m’a poussée vers le travail du sexe”, précise-t-elle. “Ils ne savaient pas que j’étais transgenre et m’achetaient des habits et des chaussures pour hommes. Ils ne voulaient pas non plus me donner de quoi me maquiller. J’ai donc commencé le travail du sexe pour me procurer ce dont j’avais besoin, pour vivre en tant que femme”.
Les brimades et les violences, de la part de l’entourage comme des forces de l’ordre, sont quotidiennes. “Certains policiers m’appellent Diable parce que, d’après eux, je suis homme qui se fait passer pour une femme”, soupire Maya. “Ils m’ont donné des coups de bâton à plusieurs reprises, alors que je marchais dans la rue. Les gens du quartier ne comprennent pas mon identité de genre. J’ai souvent peur de marcher dans la rue, je ne suis pas à l’aise et je crains pour ma sécurité pendant la journée”.
Des violations systémiques des droits des travailleuses du sexe
Déjà fragilisées par les nombreuses discriminations qu’elles subissent en tant que femme et/ou en tant que femme transgenre, les travailleuses du sexe sont par ailleurs confrontées à des violations systémiques de leurs droits. En effet, si le code pénal burundais ne réprime pas le travail du sexe en soi, dans la pratique, les femmes qui le pratiquent peuvent être arrêtées arbitrairement pour “racolage” et “outrage aux bonnes moeurs”. Cynthia le confirme : “Parfois, les policiers nous pourchassaient avec mes consoeurs”. Maya, elle, a été emprisonnée pendant deux jours, car elle cherchait des clients dans un bar.
En raison de ces violences et discriminations qu’elles subissent, les travailleuses du sexe n’ont pas un réel accès à la santé et sont largement plus touchées par le VIH que la population générale. Cynthia et Maya ne s’en cachent pas. Elles vivent toutes les deux avec le virus. Et c’est à l’ANSS qu’elles ont toutes les deux trouvé des services de prise en charge adaptés à leurs besoins et à leur situation. “Lorsque nous avons décidé d’avoir un bébé avec mon partenaire actuel, l’ANSS nous a offert un accompagnement médical et psychologique”, sourit Cynthia. “Je me considère en bonne santé.” Maya jubile : “C’est grâce à l’ANSS que je peux avoir accès aux soins médicaux. Aujourd’hui, j’ai une charge virale indétectable, c’est-à-dire que je ne transmets plus le virus !”
Propos recueillis à Bujumbura (Burundi) en février 2020 par Patrick Uwimana, ANSS. Les propos ont été édités et condensés pour plus de clarté.